Dans le domaine de l’éthologie, l’étude du comportement animal, une perspective révolutionnaire gagne du terrain : l’idée selon laquelle les animaux non humains peuvent être des agents moraux.
Jordi Casamitjana, éthologue de renom, se penche sur cette idée provocatrice, remettant en question la croyance de longue date selon laquelle la moralité est un trait exclusivement humain. Grâce à une observation méticuleuse et à une enquête scientifique, Casamitjana et d’autres scientifiques avant-gardistes affirment que de nombreux animaux possèdent la capacité de discerner le bien du mal, les qualifiant ainsi d’agents moraux. Cet article explore les preuves étayant cette affirmation, en examinant les comportements et les interactions sociales de diverses espèces qui suggèrent une compréhension complexe de la moralité. De l’équité ludique observée chez les canidés aux actes altruistes chez les primates et à l’empathie chez les éléphants, le règne animal révèle une tapisserie de comportements moraux qui nous obligent à reconsidérer nos visions anthropocentriques. Alors que nous découvrons ces découvertes, nous sommes invités à réfléchir aux implications éthiques de la manière dont nous interagissons avec et percevons les habitants non humains de notre planète. **Introduction : « Les animaux peuvent aussi être des agents moraux »**
Dans le domaine de l’éthologie, l’étude du comportement animal, une perspective révolutionnaire gagne du terrain : la notion selon laquelle les animaux non humains peuvent être des agents moraux. Jordi Casamitjana, éthologue de renom, se penche sur cette idée provocatrice, remettant en question la croyance de longue date selon laquelle la moralité est un trait exclusivement humain. Grâce à une observation méticuleuse et à une enquête scientifique, Casamitjana et d'autres scientifiques avant-gardistes affirment que de nombreux animaux possèdent la capacité de discerner le bien du mal, se qualifiant ainsi d'agents moraux. Cet article explore les preuves étayant cette affirmation, en examinant les comportements et les interactions sociales de diverses espèces qui suggèrent une compréhension complexe de la moralité. De l’équité ludique observée chez les canidés aux actes altruistes chez les primates et à l’empathie chez les éléphants, le règne animal révèle une tapisserie de comportements moraux qui nous obligent à reconsidérer nos visions anthropocentriques. Au fur et à mesure que nous décryptons ces découvertes, nous sommes invités à réfléchir aux implications éthiques de la façon dont nous interagissons avec et percevons les habitants non humains de notre planète.
L'éthologue Jordi Casamitjana examine comment les animaux non humains pourraient être décrits comme des agents moraux, car beaucoup sont capables de connaître la différence entre le bien et le mal.
C'est arrivé à chaque fois.
Quand quelqu’un affirme avec insistance qu’il a identifié un trait absolument unique à l’espèce humaine, tôt ou tard, quelqu’un d’autre trouvera des preuves de ce trait chez d’autres animaux, quoique peut-être sous une forme ou à un degré différent. Les humains suprémacistes justifient souvent leur vision erronée selon laquelle les êtres humains sont l’espèce « supérieure » en utilisant certains traits de caractère positifs, certaines facultés mentales ou certaines particularités comportementales qu’ils croient propres à notre espèce. Cependant, avec suffisamment de temps, des preuves que celles-ci ne sont pas propres à nous mais peuvent également être trouvées chez d'autres animaux apparaîtront très probablement.
Je ne parle pas de configurations particulières et uniques de gènes ou de compétences que possède chaque individu, car aucun individu n’est identique (pas même des jumeaux), et leur vie ne le sera pas non plus. Bien que le caractère unique des individus soit également partagé avec toutes les autres espèces, ceux-ci ne définiront pas l’espèce dans son ensemble, mais seront plutôt l’expression d’une variabilité normale. Je parle de traits distinctifs qui sont considérés comme « définissant » notre espèce parce qu'ils sont typiques, que l'on retrouve couramment chez nous tous et apparemment absents chez d'autres animaux, qui peuvent être conceptualisés de manière plus abstraite afin de ne pas en faire une culture, une population ou une culture. personne dépendante.
Par exemple, la capacité de communiquer avec la langue parlée, la capacité de cultiver la nourriture, la compétence à utiliser des outils pour manipuler le monde, etc. Tous ces traits ont été utilisés autrefois pour placer «l'humanité» dans une catégorie «supérieure» distincte au-dessus de toutes les autres créatures, mais ont été trouvées plus tard chez d'autres animaux, alors ils ont cessé d'être utiles aux suprémacistes humains. Nous savons que de nombreux animaux communiquent entre eux par la voix et ont un langage qui varie parfois de la population à la population créant des «dialectes», similaires à ce qui se passe avec le langage humain (comme dans les cas d'autres primates et de nombreux oiseaux chanteurs). Nous savons également que certaines fourmis, termites et coléoptères cultivent des champignons d'une manière très similaire, les humains cultivent les cultures. Et depuis que le Dr Jane Goodall a découvert comment les chimpanzés ont utilisé des bâtons modifiés pour obtenir des insectes, l'utilisation d'outils a été trouvée dans de nombreuses autres espèces (orangs-outans, corbeaux, dauphins, oiseaux de bower, éléphants, loutres, poulpes, etc.).
Il existe un de ces « superpouvoirs » que la plupart des gens croient encore être uniquement humain : la capacité d’être des agents moraux qui comprennent le bien et le mal et peuvent donc être tenus responsables de leurs actes. Eh bien, comme dans tous les autres, considérer ce trait qui nous est propre s’est avéré être une énième présomption prématurée et arrogante. Bien que cela ne soit toujours pas accepté par la science dominante, un nombre croissant de scientifiques (moi y compris) croient désormais que les animaux non humains peuvent également être des agents moraux, car nous avons déjà trouvé suffisamment de preuves le suggérant.
Éthique et morale
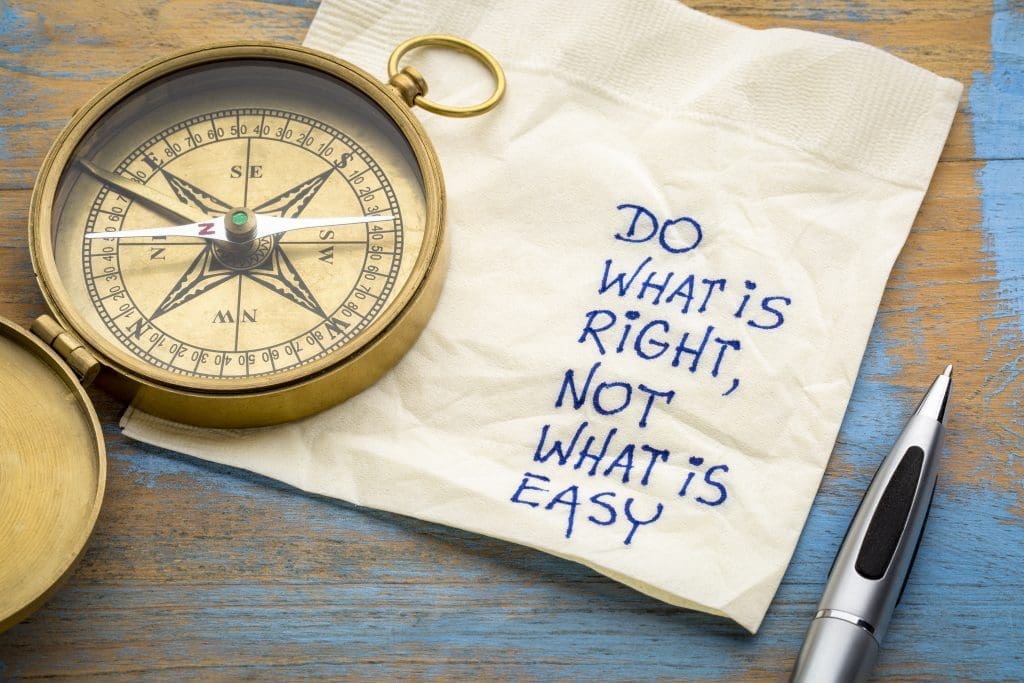
Les mots éthique et moral sont souvent utilisés comme synonymes, mais il ne s’agit pas tout à fait du même concept. Ce qui les différencie est crucial pour cet article, car j’affirme que les animaux non humains peuvent aussi être des agents moraux, mais pas nécessairement des agents éthiques. Il serait donc bon de consacrer d’abord un peu de temps à définir ces concepts.
Les deux concepts traitent des idées de «bien» et de «mal» (et le plus relatif «juste» et «injuste» équivalent), et des règles qui régissent le comportement d'un individu basé sur de telles idées, mais la différence réside dans les règles de laquelle nous parlons. L'éthique se réfère à des règles de conduite dans un groupe particulier reconnu par une source externe ou un système social , tandis que la morale se réfère à des principes ou des règles relatives à une conduite bonne ou mauvaise basée sur la compasse individuelle ou de groupe du bien et du mal. En d'autres termes, chaque groupe (ou même les individus) peut créer leurs propres règles morales, et ceux du groupe qui les suivent se comportent «à juste titre», tandis que ceux qui les brisent se comportent «à tort». De l'autre côté, des individus ou des groupes qui régissent leur comportement par des règles créées à l'extérieur qui prétendent être plus universelles et ne pas dépendantes de groupes ou d'individus particuliers, ils suivent des règles éthiques. Looking at the extremes of both concepts, on one side we can find a moral code that only applies to one individual (that individual has created personal rules of conduct and follows them without necessarily sharing them with anyone else), and on the other extreme a philosopher may be trying to draft an ethical code based on universal principles drawn from all religions, ideologies, and cultures, claiming that this code applies to all human beings (Ethical principles may be discovered by philosophers plutôt que créé parce que certains peuvent être naturels et vraiment universels).
À titre d'exemple hypothétique de moralité, un groupe d'étudiants japonais partageant un logement peut créer ses propres règles sur la façon de vivre ensemble (par exemple, qui nettoie quoi, à quelle heure ils doivent arrêter de jouer de la musique, qui paie les factures et le loyer, etc. ), et ceux-ci constitueront la moralité de cet appartement. Les élèves sont censés suivre les règles (faire le bien), et s'ils les enfreignent (faire le mal), il devrait y avoir des conséquences négatives pour eux.
À l’inverse, comme exemple hypothétique d’éthique, le même groupe d’étudiants japonais pourrait être tous des chrétiens qui suivent l’Église catholique. Ainsi, lorsqu’ils font quelque chose contre la doctrine catholique, ils enfreignent leur éthique religieuse. L'Église catholique affirme que ses règles du bien et du mal sont universelles et s'appliquent à tous les êtres humains, qu'ils soient catholiques ou non, et c'est pourquoi leur doctrine est basée sur l'éthique et non sur la morale. Cependant, le code moral des étudiants (les règles de l'appartement qu'ils ont acceptées) peut très bien être basé dans une large mesure sur le code éthique de l'Église catholique, de sorte qu'une transgression d'une règle particulière peut être à la fois une transgression d'un code éthique et un code moral (et c’est pourquoi les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes).
Pour rendre la situation encore plus confuse, le terme « éthique » en lui-même est souvent utilisé pour désigner la branche de la philosophie qui étudie l'équité et la justesse dans le raisonnement et le comportement humains, et donc les questions liées aux codes moraux et éthiques. Les philosophes ont tendance à suivre l’une des trois écoles d’éthique différentes. D’un côté, « l’éthique déontologique » détermine la justesse à la fois des actes et des règles ou devoirs que la personne qui accomplit l’acte essaie de remplir et, par conséquent, identifie les actions comme étant intrinsèquement bonnes ou mauvaises. L’un des philosophes des droits des animaux les plus influents défendant cette approche était l’Américain Tom Regan, qui soutenait que les animaux possédaient une valeur en tant que « sujets d’une vie » parce qu’ils ont des croyances, des désirs, une mémoire et la capacité d’initier des actions en vue de poursuivre leurs objectifs. objectifs. Ensuite, nous avons « l’éthique utilitariste », qui considère que la ligne de conduite appropriée est celle qui maximise un effet positif. Un utilitariste peut soudainement changer de comportement si les chiffres ne le soutiennent plus. Ils pourraient aussi « sacrifier » une minorité au profit de la majorité. L'utilitariste le plus influent en matière de défense des droits des animaux est l'Australien Peter Singer, qui soutient que le principe « le plus grand bien du plus grand nombre » devrait être appliqué aux autres animaux, la frontière entre humain et « animal » étant arbitraire. Enfin, la troisième école est l'école de « l'éthique fondée sur la vertu », qui s'inspire des travaux d'Aristote qui affirmait que les vertus (telles que la justice, la charité et la générosité) prédisposent à la fois la personne qui les possède et la société de cette personne. façon dont ils agissent.
Par conséquent, le comportement des gens peut être régi par leur propre morale privée, la morale de la communauté dans laquelle ils vivent, l'une des trois écoles d'éthique (ou plusieurs d'entre elles, chacune appliquée dans des circonstances différentes) et les codes éthiques spécifiques des religions ou des idéologies. Des règles particulières concernant un comportement spécifique peuvent être les mêmes dans tous ces codes moraux et éthiques, mais certaines peuvent entrer en conflit les unes avec les autres (et l'individu peut avoir une règle morale sur la manière de gérer de tels conflits).
Par exemple, regardons mes choix philosophiques et comportementaux actuels. J'applique l'éthique déontologique pour des actions négatives (il y a des choses nuisibles que je ne ferais jamais parce que je les considère intrinsèquement erronées) mais l'éthique utilitaire dans des actions positives (j'essaie d'aider ceux qui ont besoin de plus d'aide d'abord et de choisir le comportement qui profite au plus de individus). Je ne suis pas religieux, mais je suis un végétalien éthique, donc je suis l'éthique de la philosophie du véganisme (je considère les principaux axiomes du véganisme comme des principes universels qui devraient être suivis par tous les humains décents). Je vis moi-même, donc je n'ai pas à souscrire à des règles «d'appartement», mais je vis à Londres et je respecte la moralité d'un bon Londonien suivant les règles écrites et non écrites de ses citoyens (comme se tenir à droite dans les escaliers mécaniques ). En tant que zoologiste, je respecte également le code de conduite professionnel de la moralité de la communauté scientifique. J'utilise la définition officielle du véganisme de la société végétalienne comme ma base morale, mais ma moralité me pousse à aller au-delà et à l'appliquer dans un sens plus large que ce qui est strictement défini (par exemple, en plus de essayer de ne pas nuire aux êtres sensibles comme le dictent le véganisme, j'essaie également d'éviter de nuire à tout être vivant, sensible ou non). Cela m'a fait essayer d'éviter de tuer une plante inutilement (même si je n'ai pas toujours réussi). J'ai également une règle morale personnelle qui m'a fait essayer d'éviter d'utiliser des bus au printemps et en été si j'ai une alternative de transport public réalisable car je veux éviter d'être dans un véhicule qui a accidentellement tué un insecte volant). Par conséquent, mon comportement est régi par une série de codes éthiques et moraux, certaines de leurs règles partagées avec d'autres, tandis que d'autres ne le sont pas, mais si je brise l'une d'entre elles, je considère que j'ai fait du «mal» (que j'aie été «capturée» ou que je suis punie pour cela).
Agence morale sur les animaux non humains

L'un des scientifiques qui ont plaidé pour la reconnaissance de certains animaux non humains comme êtres moraux est l'éthologue américain Marc Bekoff , que j'ai eu le privilège d' interviewer récemment . Il a étudié le comportement social de jeu chez les canidés (comme les coyotes, les loups, les renards et les chiens) et en observant comment les animaux interagissaient les uns avec les autres pendant le jeu, il a conclu qu'ils avaient des codes moraux qu'ils suivent parfois, parfois ils enfreignent, et lorsqu'ils les freiner, il y aurait des conséquences négatives qui permettraient aux individus d'apprendre la moralité sociale du groupe. En d’autres termes, au sein de chaque société d’animaux qui jouent, les individus apprennent les règles et, par un sentiment d’équité, apprennent quel comportement est bon et ce qui ne l’est pas. Dans son livre influent « La vie émotionnelle des animaux » (dont une nouvelle édition vient de paraître), il écrit :
« Dans sa forme la plus élémentaire, la moralité peut être considérée comme un comportement « prosocial » – un comportement visant à promouvoir (ou du moins à ne pas diminuer) le bien-être des autres. La moralité est essentiellement un phénomène social : elle surgit dans les interactions entre et parmi les individus, et elle existe comme une sorte de sangle ou de tissu qui maintient ensemble une tapisserie complexe de relations sociales. Le mot moralité est depuis devenu un raccourci pour faire la différence entre le bien et le mal, entre le bien et le mal.
Bekoff et d'autres ont découvert que les animaux non humains font preuve d'équité lorsqu'ils jouent et réagissent négativement à un comportement injuste. Un animal qui enfreint les règles du jeu (comme mordre trop fort ou ne pas réduire la vigueur de ses actions physiques lorsqu'il joue avec quelqu'un de beaucoup plus jeune – ce qu'on appelle l'auto-handicap) serait considéré par les autres membres du groupe comme ayant mal agi. , et soit être grondé, soit ne pas être traité favorablement lors d'autres interactions sociales. L’animal qui a fait le mal peut corriger son erreur en demandant pardon, et cela peut fonctionner. Chez les canidés, les « excuses » pendant le jeu prendront la forme de gestes spécifiques tels que « l'arc de jeu », composé d'une ligne du dessus inclinée vers la tête, la queue tenue horizontalement à la verticale, mais pas en dessous de la ligne du dessus, un corps détendu et visage, oreilles tenues au milieu du crâne ou vers l'avant, membres antérieurs touchant le sol de la patte au coude et queue remuant. L’arc de jeu est aussi la posture du corps qui signale « Je veux jouer », et quiconque observe des chiens dans un parc peut le reconnaître.
Bekoff écrit: «Les chiens ne tolèrent pas les tricheurs non coopératifs, qui peuvent être évités ou chassés des groupes de jeu. Lorsque le sentiment d'équité d'un chien est violé, il y a des conséquences.» Lorsqu'il a étudié les coyotes, Bekoff a constaté que les chiots de coyote qui ne jouent pas autant que les autres parce qu'ils sont évités par d'autres sont plus susceptibles de quitter le groupe, ce qui a un coût car cela augmente les chances de mourir. Dans une étude qu'il a fait avec des coyotes dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming, il a constaté que 55% des yearlings qui se sont éloignés de leur groupe sont morts, tandis que moins de 20% de ceux qui sont restés avec le groupe l'ont fait.
Par conséquent, en apprenant du jeu et d’autres interactions sociales, les animaux attribuent les étiquettes de « bien » et de « mauvais » à chacun de leurs comportements et apprennent la moralité du groupe (qui peut être différente de celle d’un autre groupe ou d’une autre espèce).
Les agents moraux sont normalement définis comme des personnes qui ont la capacité de discerner le bien du mal et d'être tenues responsables de leurs propres actions. J'utilise normalement le terme «personne» comme un être avec une personnalité distinctive qui a une identité interne et externe, donc pour moi, cette définition s'appliquerait également aux êtres non sensibles. Une fois que les animaux ont appris quels comportements sont considérés comme bons et mauvais dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, ils peuvent choisir comment se comporter en fonction de ces connaissances, devenant des agents moraux. Il se peut qu'ils aient acquis une partie de ces connaissances instinctivement de leurs gènes, mais s'ils l'ont fait en apprenant par le jeu ou les interactions sociales, une fois qu'ils atteignent l'âge adulte et connaissent la différence entre se comporter correctement et se comporter à tort, ils sont devenus des agents moraux responsables de leurs actions. adultes).
Cependant, comme nous le verrons plus tard, enfreindre un code moral vous rend uniquement responsable envers le groupe qui détient ce code, et non envers d'autres groupes avec des codes différents auxquels vous n'avez pas adhéré (en termes humains, quelque chose qui est illégal – voire immoral – dans un pays ou une culture peut être autorisé dans un autre).
Certaines personnes pourraient affirmer que les animaux non humains ne peuvent pas être des agents moraux parce qu’ils n’ont pas le choix puisque tout leur comportement est instinctif, mais c’est une vision très démodée. Il existe désormais un consensus parmi les éthologues sur le fait que, du moins chez les mammifères et les oiseaux, la plupart des comportements proviennent d’une combinaison d’instincts et d’apprentissage, et que la dichotomie en noir et blanc entre nature et culture ne tient plus la route. Les gènes peuvent prédisposer à certains comportements, mais les effets de l'environnement sur le développement et l'apprentissage tout au long de la vie peuvent les moduler jusqu'à leur forme finale (qui peut varier en fonction de circonstances externes). Cela s'applique également aux humains, donc si nous acceptons que les humains, avec tous leurs gènes et leurs instincts, peuvent être des agents moraux, il n'y a aucune raison de croire que l'action morale ne pourrait pas être trouvée chez d'autres animaux dotés de gènes et d'instincts très similaires (en particulier d'autres organismes sociaux). primates comme nous). Les suprémacistes voudraient que nous appliquions des normes éthologiques différentes aux humains, mais la vérité est qu’il n’existe aucune différence qualitative dans le développement de notre répertoire comportemental qui justifierait cela. Si nous acceptons que les humains peuvent être des agents moraux et ne sont pas des machines déterministes non responsables de leurs actions, nous ne pouvons pas nier le même attribut à d’autres animaux sociaux capables d’apprendre et de moduler leur comportement avec l’expérience.
Preuve du comportement moral chez les animaux non humains

Pour trouver des preuves de moralité chez les animaux non humains, il suffit de trouver des preuves d'espèces sociales dont les individus se reconnaissent et jouent. Il y en a beaucoup qui le font. Il existe des milliers d'espèces sociales sur la planète, et la plupart des mammifères, même ceux des espèces solitaires, jouent avec leurs frères et sœurs lorsqu'ils sont jeunes, mais bien que tout cela utilise le jeu pour entraîner leur corps aux comportements dont ils ont besoin pour se perfectionner à l'âge adulte, les mammifères et les oiseaux utiliseront également le jeu pour découvrir qui est qui dans leur société et quelles sont les règles morales de leur groupe. Par exemple, des règles telles que ne pas voler de nourriture à quelqu'un au-dessus de vous dans la hiérarchie, ne pas jouer trop brutalement avec les bébés, toiletter les autres pour faire la paix, ne pas jouer avec quelqu'un qui ne veut pas jouer, ne pas jouer avec le bébé de quelqu'un sans permission, partager de la nourriture avec votre progéniture, défendre vos amis, etc. Si nous devions déduire de ces règles des concepts plus élevés (comme le font souvent les anthropologues lorsqu'ils étudient la moralité des groupes humains), nous utiliserions des termes tels que l'honnêteté, l'amitié, la tempérance, la politesse, la générosité ou le respect, qui seraient des vertus que nous attribuons aux êtres moraux.
Certaines études ont montré que les animaux non humains sont parfois disposés à aider les autres à leurs propres dépens (ce que l'on appelle l'altruisme), soit parce qu'ils ont appris que c'est le bon comportement attendu d'eux par les membres de leur groupe, soit parce que leur moralité personnelle (appris ou innés, conscients ou inconscients) leur a ordonné de se comporter de cette façon. Un comportement altruiste de ce type a été démontré par des pigeons (Watanabe et Ono 1986), des rats (Church 1959 ; Rice et Gainer 1962 ; Evans et Braud 1969 ; Greene 1969 ; Bartal et al. 2011 ; Sato et al. 2015) et plusieurs primates (Masserman et al. 1964 ; Wechkin et al. 1964 ; Warneken et Tomasello 2006 ; Burkart et al. 2007 ; Warneken et al. 2007 ; Lakshminarayanan et Santos 2008 ; Cronin et al. 2010 ; Horner et al. 2011 ; Schmelz et al.2017).
Des preuves d'empathie et de soins envers les autres en détresse ont également été trouvées chez les corvidés (Seed et al. 2007 ; Fraser et Bugnyar 2010), les primates (de Waal et van Roosmalen 1979 ; Kutsukake et Castles 2004 ; Cordoni et al. 2006 ; Fraser et al. 2008 ; Clay et de Waal 2013 ; . 2016), les chevaux (Cozzi et al. 2010) et les campagnols des prairies (Burkett et al. 2016).
L'aversion aux inégalités (IA), la préférence pour l'équité et la résistance aux inégalités fortuites, a également été observée chez les chimpanzés (Brosnan et al. 2005, 2010), les singes (Brosnan et de Waal 2003 ; Cronin et Snowdon 2008 ; Massen et al. 2012). ), les chiens (Range et al. 2008) et les rats (Oberliessen et al. 2016).
Si les humains ne voient pas la moralité chez les autres espèces, même lorsque les preuves dont ils disposent sont similaires aux preuves que nous acceptons lorsque nous examinons le comportement des humains de différents groupes, cela ne fait que montrer les préjugés de l'humanité, ou un effort pour supprimer le comportement moral des autres. Susana Monsó, Judith Benz-Schwarzburg et Annika Bremhorst, auteurs de l'article de 2018 « Animal Morality: What It Means and Why It Matters », qui a compilé toutes ces références ci-dessus, ont conclu : « Nous avons trouvé de nombreux contextes, y compris des procédures de routine dans dans les fermes, les laboratoires et dans nos maisons, où les humains peuvent potentiellement interférer, entraver ou détruire les capacités morales des animaux.
Certains animaux ont même été vus jouer spontanément avec des membres d'autres espèces (autres que les humains), ce que l'on appelle le jeu social intraspécifique (ISP). Il a été signalé chez les primates, les cétacés, les carnivores, les reptiles et les oiseaux. Cela signifie que la moralité suivie par certains de ces animaux peut se croiser avec celle d’autres espèces – peut-être en s’appuyant sur des règles éthiques plus celles des mammifères ou des vertébrés. De nos jours, avec l’avènement des médias sociaux, nous pouvons trouver de nombreuses vidéos montrant des animaux de différentes espèces jouant les uns avec les autres – et semblant comprendre les règles de leurs jeux – ou même s’entraider de ce qui semble être complètement altruiste – faire ce que nous devrions décrire comme de bonnes actions caractéristiques des êtres moraux.
Chaque jour, de plus en plus de preuves s’opposent à l’idée selon laquelle les humains sont les seuls êtres moraux sur la planète Terre.
Implications pour le débat sur la souffrance des animaux sauvages

Mark Rowlands, auteur des mémoires à succès international Le Philosophe et le loup , a soutenu que certains animaux non humains peuvent être des créatures morales capables de se comporter sur la base de motivations morales. Il a déclaré que les émotions morales telles que « la sympathie et la compassion, la gentillesse, la tolérance et la patience, ainsi que leurs contreparties négatives telles que la colère, l'indignation, la méchanceté et la méchanceté », ainsi que « le sens de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas » », peut être trouvé chez les animaux non humains. Cependant, il a déclaré que, même si les animaux manquent probablement des types de concepts et de capacités métacognitives nécessaires pour être tenus moralement responsables de leur comportement, cela ne fait que les exclure de la possibilité d'être considérés comme des agents moraux. Je suis d'accord avec son point de vue, sauf sur cette affirmation ultérieure, car je crois que les êtres moraux sont également des agents moraux (comme je l'ai soutenu plus tôt).
Je soupçonne que Rowlands a déclaré que certains animaux non humains peuvent être des êtres moraux mais pas des agents moraux en raison de l'influence du débat sur la souffrance des animaux sauvages. Ceci est centré sur la question de savoir si les personnes qui se soucient de la souffrance des autres devraient essayer de réduire la souffrance des animaux à l'état sauvage en intervenant dans les interactions prédatrices / proies, et d'autres formes de souffrance causées par d'autres animaux non humains. De nombreux végétaliens, comme moi, préconisent de laisser la nature seule et non seulement de se concentrer sur l'empêche de l'homme de gâcher la vie des animaux exploités, mais même de renoncer à une partie du terrain que nous avons volé et de le ramener à la nature (j'ai écrit un article sur ce cas végétalien pour le réévolution ).
Cependant, une minorité de végétaliens ne sont pas d'accord avec cela et, faisant appel à l'erreur de la nature, affirme que la souffrance des animaux sauvages infligée par d'autres animaux sauvages est également importante et que nous devons intervenir pour la réduire (peut-être empêcher les prédateurs de tuer des proies, voire réduisant la taille des écosystèmes naturels pour réduire la quantité de souffrance des animaux qui y sont). Il existe des «éliminatoires de prédation». Certains membres - pas tous - du «mouvement de souffrance des animaux sauvages récemment étiquetés» (dans lequel des organisations telles que l'éthique animale et l'initiative animale sauvage jouent un rôle important) ont préconisé ce point de vue.
L’une des réponses les plus courantes de la communauté végétalienne dominante à des points de vue aussi inhabituels – et extrêmes – est de dire que les animaux sauvages ne sont pas des agents moraux et que les prédateurs ne sont donc pas responsables du meurtre de proies, car ils ne savent pas que tuer d’autres êtres sensibles peut être une mauvaise chose. faux. Il n’est donc pas surprenant que lorsque ces végétaliens voient d’autres comme moi dire que les animaux non humains sont également des agents moraux (y compris les prédateurs sauvages), ils deviennent nerveux et préféreraient que ce ne soit pas vrai.
Cependant, il n’y a aucune raison d’être nerveux. Nous affirmons que les animaux non humains sont des agents moraux, et non des agents éthiques, et que, compte tenu de ce que nous avons discuté plus tôt sur la différence entre ces deux concepts, c'est ce qui nous permet de toujours être en mesure de soutenir simultanément que nous ne devrions pas intervenir. dans la nature et que de nombreux animaux sauvages sont des agents moraux. Le point clé est que les agents moraux ne commettent le mal que lorsqu’ils transgressent l’un de leurs codes moraux, mais ils ne sont pas responsables envers les humains, mais uniquement envers ceux qui « signent » le code moral avec eux. Un loup qui a fait quelque chose de mal n’a de comptes à rendre qu’à la communauté des loups, pas à la communauté des éléphants, à la communauté des abeilles ou à la communauté humaine. Si ce loup a tué un agneau qu'un berger humain prétend posséder, le berger peut penser que le loup a fait quelque chose de mal, mais le loup n'a rien fait de mal car il n'a pas enfreint le code moral du loup.
C'est précisément l'acceptation que les animaux non humains peuvent être des agents moraux qui renforcent encore plus l'attitude de laisser la nature seule. Si nous considérons d'autres espèces animales comme des «nations», il est plus facile à comprendre. De la même manière, nous ne devons pas intervenir dans les lois et politiques des autres pays humains (par exemple, le véganisme éthique est légalement protégé au Royaume-Uni mais pas aux États-Unis, mais cela ne signifie pas que la Grande-Bretagne devrait envahir les États-Unis à corriger ce problème), nous ne devons pas intervenir dans les codes moraux des autres pays animaux. Notre intervention dans la nature devrait être limitée à la réparation des dommages que nous avons causés et à «retirer» des écosystèmes vraiment naturels qui sont auto-entretenus car il est probable que dans ceux-ci, il y a moins de souffrance nette que tout habitat de fabrication humaine (ou un habitat naturel avec lequel nous avons gâché le point qu'il n'est plus écologiquement équilibré).
Laisser la nature tranquille ne signifie pas ignorer la souffrance des animaux sauvages que nous rencontrons, ce serait spéciste. Les animaux sauvages comptent autant que les animaux domestiques. Je suis favorable au sauvetage des animaux échoués que nous rencontrons, à la guérison d'animaux sauvages blessés qui peuvent être réhabilités dans la nature, ou à la mise hors de sa misère d'un animal sauvage angoissant qui ne peut être sauvé. Dans mon livre Ethical Vegan et dans l’article que j’ai mentionné, je décris « l’approche d’implication dans l’épreuve » que j’utilise pour décider quand intervenir. Laisser la nature tranquille signifie reconnaître à la fois la souveraineté de la nature et la faillibilité humaine, et considérer le « réensauvagement antispéciste » axé sur les écosystèmes comme une intervention acceptable.
Le libre arbitre moral chez les chats et les chiens est peut-être une autre histoire, car beaucoup de ceux qui sont des animaux de compagnie ont en quelque sorte « signé » un contrat avec leurs compagnons humains, ils partagent donc le même code moral. Le processus de « dressage » des chats et des chiens pourrait être considéré comme la « négociation » d’un tel contrat (tant qu’il n’est pas aversif et qu’il y a consentement), et de nombreux chats ou chiens sont satisfaits des termes tant qu’ils le sont. nourris et hébergés. S’ils enfreignent l’une des règles, leurs compagnons humains le leur feront savoir de diverses manières (et quiconque vit avec des chiens a vu le « visage coupable » qu’ils vous montrent souvent lorsqu’ils savent qu’ils ont fait quelque chose de mal). Cependant, un oiseau exotique gardé captif dans une cage comme animal de compagnie n'a pas signé ce contrat, donc tout dommage causé en tentant de s'échapper ne devrait entraîner aucune punition (ces humains qui les gardent captifs sont ceux qui ont tort ici).
Les animaux non humains comme agents éthiques ?

Dire que les animaux non humains peuvent être des agents moraux ne signifie pas que toutes les espèces le peuvent, ou que tous les individus de celles qui le peuvent seront de « bons » animaux. Il ne s’agit pas d’angéliser l’animalité non humaine, mais de niveler les autres animaux et de nous retirer de notre faux piédestal. Comme chez les humains, les animaux non humains peuvent être bons ou mauvais, saints ou pécheurs, anges ou démons, et comme pour les humains, être dans la mauvaise compagnie dans le mauvais environnement peut aussi les corrompre (pensez aux combats de chiens).
Pour être honnête, je suis plus sûr que les humains ne sont pas les seuls agents moraux sur la planète Terre que que tous les êtres humains sont des agents moraux. La plupart des humains ne se sont pas assis pour rédiger leurs règles morales ni prendre le temps de réfléchir aux codes moraux et éthiques auxquels ils souhaitent souscrire. Ils ont tendance à suivre l’éthique que d’autres leur disent de suivre, qu’il s’agisse de leurs parents ou des idéologues dominants de leur région. Je considérerais qu'un animal non humain qui a choisi d'être bon est plus éthique qu'un de ces humains qui suivent aveuglément la religion qui leur est assignée par loterie géographique.
Regardons Jethro, par exemple. Il était l'un des chiens de compagnie de Marc Bekoff. Les végétaliens qui donnent des aliments à base de plantes à leurs animaux de compagnie disent souvent que ces compagnons sont végétaliens, mais cela n'est peut-être pas vrai, car le véganisme n'est pas seulement un régime, mais une philosophie qu'il faut choisir de suivre. Cependant, je pense que Jethro aurait pu être un véritable chien végétalien. Dans ses livres, Marc raconte l'histoire de Jethro non seulement qui ne tue pas d'autres animaux (comme des lapins sauvages ou des oiseaux) lorsqu'il les rencontre dans la nature sauvage du Colorado où il vit, mais qui les sauve en cas de problème et les amène à Marc afin qu'il puisse aidez-les aussi. Marc écrit : « Jethro aimait les autres animaux et il en a sauvé deux de la mort. Il aurait facilement pu les manger sans effort. Mais on ne fait pas ça à des amis. « Je présume que Marc a donné à Jethro des aliments à base de plantes (car il est végétalien et au courant des recherches en cours à ce sujet), ce qui signifie que Jethro était peut-être en fait un chien végétalien car, en plus de ne pas consommer de produits d'origine animale , il avait son propre chien. moralité qui l'empêchait de faire du mal à d'autres animaux. En tant qu'agent moral qu'il était, il a choisi de ne pas nuire aux autres, et comme un végétalien est quelqu'un qui a choisi la philosophie du véganisme basée sur le principe de ne pas nuire aux autres (pas seulement à quelqu'un qui mange de la nourriture végétalienne), il a peut-être été plus végétalien qu'un adolescent influenceur qui se contente de manger des aliments à base de plantes et prend des selfies pendant qu'il le fait.
Les végétaux des droits des animaux comme moi détiennent non seulement la philosophie du véganisme, mais aussi la philosophie des droits des animaux (qui se chevauchent grandement, mais je pense qu'ils sont toujours séparés ). En tant que tels, nous avons dit que les animaux non humains ont des droits moraux, et nous nous battons pour transformer ces droits en droits légaux qui empêchent les gens de les exploiter et de permettre aux animaux non humains d'être traités comme des personnes légales qui ne peuvent pas être tuées, blessées ou privées de liberté. Mais lorsque nous utilisons le terme «droits moraux» dans ce contexte, nous signifions normalement les droits moraux au sein des sociétés humaines.
Je pense que nous devrions aller plus loin et proclamer que les animaux non humains sont des agents moraux dotés de leurs propres droits moraux, et que porter atteinte à ces droits constitue une violation des principes éthiques que nous, les humains, devrions suivre. Il ne nous appartient pas de donner leurs droits aux animaux non humains parce qu’ils les possèdent déjà et en vivent. Ils les possédaient déjà avant que les humains n’évoluent. C’est à nous de modifier nos propres droits et de veiller à ce que les humains qui portent atteinte aux droits d’autrui soient arrêtés et punis. Violer les droits fondamentaux d’autrui constitue une violation des principes éthiques auxquels l’humanité a souscrit, et cela devrait s’appliquer à tous les humains, partout dans le monde, qui ont signé pour faire partie de l’humanité (avec tous les avantages auxquels une telle adhésion donne droit).
La suprématie est un axiome carniste auquel j’ai arrêté d’adhérer lorsque je suis devenu végétalien il y a plus de 20 ans. Depuis, j’ai cessé de croire ceux qui prétendent avoir découvert une « vertu » que seuls les humains possèdent. Je suis sûr que les animaux non humains sont des agents moraux au sein de leur propre moralité qui n'a rien à voir avec la nôtre telle qu'elle était déjà établie avant notre arrivée. Mais je me demande s’ils peuvent aussi être des êtres éthiques qui sont des agents éthiques et qui suivent les principes universels du bien et du mal que les philosophes humains ont commencé à identifier récemment.
Il n’y a pas encore beaucoup de preuves de cela, mais je pense que cela pourrait bien se produire si nous accordons plus d’attention à la manière dont les animaux non humains se comportent avec les autres espèces. Peut-être que les éthologues devraient étudier davantage le jeu social intraspécifique, et que les philosophes devraient examiner les points communs des moralités extra-humaines pour voir si quelque chose émerge. Je ne serais pas surpris si c'était le cas.
Cela s’est produit chaque fois que nous ouvrons notre esprit pour accepter notre nature ordinaire.
AVIS: Ce contenu a été initialement publié sur Veganfta.com et ne peut pas nécessairement refléter les vues de la Humane Foundation.


